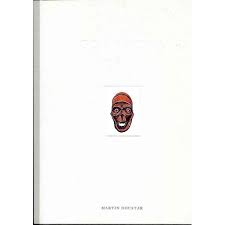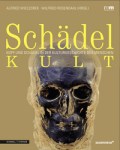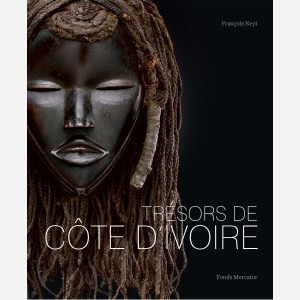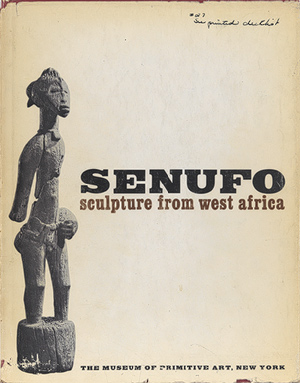
Catalogue MPA, 1964.
En 1954, Nelson A. Rockefeller, en association avec René d’Harnoncourt, alors directeur du Museum of Modern Art, établit le Museum of Primitive Art (MPA). Sous la conduite de l’historien d’art Robert Goldwater (son directeur de 1957 à 1963), le MPA parraina deux expositions marquantes : Bambara Sculpture from the Western Sudan, en 1960 et, Senufo. Sculpture from West Africa, en 1963, à l’origine des premières monographies consacrées à ces ethnies, considérées aujourd’hui encore comme des références. C’est dans la continuité de ces fameuses manifestations que Constantin Petridis, conservateur du département d’art africain au Cleveland Museum of Art, a conçu Senufo : art et identités en Afrique de l’Ouest. Cette exposition, après être passée par le Cleveland Museum of Art (22 février-31 mai) et au Saint Louis Art Museum (28 juin-27 septembre), s’arrête au musée Fabre de Montpellier pour sa seule étape européenne (28 novembre 2015-6 mars 2016). S’appuyant sur les recherches de Susan Elizabeth Gagliari, maître de conférences à l’université d’Emory, à Atlanta, qui propose une nouvelle perspective, repoussant les frontières de l’appellation sénoufo, il s’agit de la première exposition d’envergure consacrée à cette tradition artistique depuis celles de New York (1963), de Zurich (Die Kunst der Senufo, 1988) et de Berlin (Die Kunst der Senufo Elfenbeinkuste, 1990).

Figure masculine deble, groupe Tyebara, Lataha, Région des Savanes, Côte d’Ivoire. Bois. H. : 108 cm. © The Michael C. Rockefeller Memorial Collection, Gift of Nelson A. Rockefeller, 1965. Inv. 1978.412.315.
La dénomination sénoufo s’imposa dans les années 1930, après les expéditions de Carl Kjersmeier (1889-1961), de Frédéric-Henri Lem (19..-19..) et d’Albert Maesen (1915-1992). Leurs publications contribuèrent à définir un style sénoufo et à la création de grandes collections privées, notamment celle d’Helena Rubinstein. Lem, esthète voyageur, collecta des objets bamana et sénoufo au Soudan français et en Côte d’Ivoire, en 1934-1935, qu’il offrit, en 1938, à Helena Rubinstein. Il devint alors son collecteur attitré et elle finança sa publication majeure (Sculptures Soudanaises, 1948). L’inspiration que cet art suscita auprès d’artistes tels que Fernand Léger, Henri Matisse ou Pablo Picasso, contribua également à le populariser.
Ce n’est qu’à partir de la fin du XIXe siècle que la France s’engage dans la conquête territoriale du continent africain. Créée par un décret du 16 juin 1895, l’Afrique Occidentale française (A.O.F.), répond à la nécessité de coordonner, sous l’autorité d’un gouverneur général, la pénétration française à l’intérieur du continent africain. Cette fédération regroupera, entre 1895 et 1958, huit colonies. Dans un premier temps : la Côte-d’Ivoire, la Guinée et le Sénégal, rejoints plus tard par la Mauritanie, le Soudan français (Mali), le Niger, la Haute-Volta (Burkina Faso) et le Dahomey (Bénin).

Senufo Sculpture from West Africa, vue de la salle dédiée aux figures d’oiseau setyen, exposition organisée par le Museum of Primitive Art, New York, 20 février-5 mai 1963. © The Art Institute of Chicago.
L’un des premiers voyageurs qui soit passé sur les franges du pays sénoufo est René Caillié (1799-1838), en 1827-1828, suivit, en 1888, par Louis-Gustave Bingeret (1856-1936), officier et explorateur et Richard Austin Freeman (1862-1943), un chirurgien anglais qui accompagne une expédition envoyée par le Service colonial britannique dans l’Hinterland de la Gold Coast. L’administrateur colonial Maurice Delafosse (1870-1926), officie en Côte d’Ivoire et au Libéria, de 1894 à 1907. La seule monographie ethnographique qu’il consacre aux Sénoufo (1909) laisse très peu de place aux productions esthétiques. Des multiples expéditions sur le continent africain que Leo Frobenius (1873-1938) a mené, entre 1904 et 1918, il ne découvre, en traversant le Soudan français, que la partie nord du pays sénoufo, celle qui relevait de l’ancien royaume du Kènèdougou, le Gouverneur général de l’A.O.F. lui ayant interdit le passage par la Côte d’Ivoire.

Figurine féminine assise tugubélé, « Maître de la coiffe en crête de coq », centre du pays sénoufo, Côte d’Ivoire, vers 1920. H. : 24,7 cm. © Coll. privée. Photo F. Dehaen-Studio Asselberghs.
Les enquêtes ethnographiques menées par l’administrateur colonial Louis Tauxier (1871-1942), qui séjourne en Côte d’Ivoire de 1918 à 1927, font l’impasse sur les productions artistiques. Le père Pierre Knops (1898-1986), de la Société des missions africaines, exerce à Korhogo, puis à Sinématiali, de 1923 à 1928. En 1924, il aide le préfet apostolique de Korhogo, Mgr Joseph Diss, à collecter statues et masques en bois et objets en laiton. Maurice Prouteaux (18..-19..) administrateur en Côte d’Ivoire de 1904 à 1923, collecte de nombreux objets et publie divers articles consacrés aux Sénoufo. Il est le premier occidental à avoir étudié les coutumes de la ville de Kong, après sa destruction par Samori Touré, en 1897. La mission Dakar-Djibouti (1931-1933), financée par l’État français, collecte, au Soudan français, chez les Sénoufo et les Minianka, près de cent cinquante objets. Frans Olbrechts (1899-1958) mis sur pied De Ivoorkust-expeditie 1938-1939, organisée par l’Université de Gand et le Musée Vleeschuis d’Anvers, qui plaçait, à des fins comparatives, deux doctorants enquêteurs sur deux terrains différents : Pieter Jan Vandenhoute (1913-1978), dans l’Ouest ivoirien, et Albert Maesen, en pays sénoufo.

Masque-heaume kponyugu, atelier ou maître inconnu de la région de Korhogo, centre du pays sénoufo, Côte d’Ivoire, vers 1930. Bois, fibres et pigments. H. : 32,5 cm. © Rietberg Museum, Zurich, don de Rahn & Bodmer. Inv. RAF 321. Ex-coll. Emil Storrer, acquis en 1953.
C’est dans les années 1950 que le « culte de la corne » ou Massa — apparu en 1946, au Mali —, envahit la région sénoufo en menaçant la production artistique. De nombreux objets rituels ou initiatiques « pouvant tuer » sont sortis des sanctuaires et des bois sacrés et jetés, nuitamment, sur les tas d’ordures, en dehors des villages. L’engagement de deux missionnaires auprès des populations sénoufo, les pères Michel Convers (1919-2002) et Gabriel Clamens (1907-1964), leur permettra de sauver les statues deble du bois sacré de Lataha. En quelques mois, de nombreuses pièces sont également collectées par un ancien légionnaire suisse, futur galeriste : Emil Storrer (1917-1989), auquel se joint Gilbert Bochet (1923-2003), administrateur colonial féru d’ethnographie. Suivent des « acheteurs professionnels », mandatés par des musées : Hans Himmelheber (1908-2003) (Rietberg Museum de Zurich) et Bohumil Holas (1909-1979) (centre IFAN d’Abidjan). Il faut également citer Simon Escarré (1909-1999), un entrepreneur et collectionneur qui s’installe à Korhogo, en 1937. Storrer se fournira régulièrement chez lui.
« Les Sénoufo »
par Pierre Harter*
Les Sénoufo appartiennent au groupe linguistique voltaïque ou gour et dépassent aujourd’hui deux millions d’individus. Ils se répartissent en une trentaine de sous-groupes, partagés entre le Mali, le Burkina Faso et, surtout, la Côte d’Ivoire, où se trouve Korhogo, leur centre principal. Si les objets sculptés jouent chez eux un certain rôle dans les cultes individuels de moindre importance (rites familiaux, divinatoires et jets de sorts), ils sont surtout liés aux liturgies complexes et encore fort méconnues, de la très importante et très secrète société initiatique poro ou lo, aboutissement logique d’une certaine conception évolutive du monde. Le poro dépasse largement l’aire d’influence Sénoufo, et s’étend jusqu’en Guinée (Kono, Toma), au Libéria (Mano, Kpellé ou Guerzé, Dan Geh, Dan Guio, Kra, Konor, Buzi, Gbandé et Bassa) et, en Sierra-Léone (Sherbro, Kissi et Mendé).

Figure féminine deble, Sénoufo, Maître de Folona, région de Sikasso, nord de la Côte d’Ivoire. Bois, cauris, graines de pois rouges et latex. H. : 90,5 cm. Ex-coll. F.-H. Lem, 1935 ; Helena Rubinstein. © Collection particulière. BAMW Photography.
Selon la mythologie, l’architecte de l’univers Koutiéléo, dont le sexe est ambigu, sépara d’abord les eaux de la terre. Puis, il créa les cinq animaux mystiques qui préfigurent les cinq principales familles Sénoufo : le caméléon, premier né, symbolisant l’intelligence ; le python, rappelant l’eau fécondante et vecteur mâle de la vie ; le calao, associé à la notion de procréation, puis le crocodile et la tortue. Lors d’une seconde phase, l’homme apparut, mais seulement en tant qu’être vivant, et demeurant en une sorte d’animalité. Ce n’est qu’en une troisième phase que l’homme fut “illuminé”, commémorée et renouvelée par l’initiation du poro dont le but consiste à révéler aux néophytes le sens de l’univers, les techniques, la domesticité des animaux et la culture des plantes. La légende enseigne qu’ensuite, les collectivités s’organisèrent en microcosmes complets, Koutiéléo s’incarnant dans chaque village en un substitut agissant femelle que l’on nomme Katiéléo, la “vieille mère”. Le dieu suprême, n’est jamais sculpté, mais seulement représenté par des symboles.
Les membres du poro reçoivent un enseignement exceptionnellement long, donné par degrés, souvent trimestriels, et pouvant s’étendre sur trois phases de sept années. Ils obéissent à une hiérarchie rigoureuse et complexe. Ils s’expriment alors en une langue archaïque ou tiga, désignant ainsi chaque objet par un nouveau vocable, qui double son nom profane. Ceci crée souvent la confusion dans la nomenclature des objets, les termes pouvant aussi changer selon les fractions ethniques. Chaque promotion constitue une sorte de classe d’âge, utilisant des objets sculptés qui lui sont propres, et qui, contrairement aux Dogon et aux Bambara, ne sont pas réalisés par la caste des forgerons mais par des sculpteurs professionnels, les kulebele.
La plus grande part de l’initiation est donnée dans le bosquet sacré sinzanga, centré par une clairière, où se trouvent des cases qui recèlent les objets liturgiques. Ce sont de vrais sanctuaires, que ferment de magnifiques portes, sculptées sur leur face extérieure. Au milieu de ces panneaux, figure un relief circulaire en forme d’ombilic, signe bénéfique associé à la case. Il est entouré d’un cercle solaire, d’où divergent quatre rayons, orientés vers les coins. Au-dessus et au-dessous, figurent des animaux, personnages ou masques, dont la tête est orientée vers le centre.
La clôture du stage des adolescents est marquée par la prise de grade kwonro. Durant cette cérémonie, les initiés défilent, coiffés d’une calotte en rotin surmontée d’une planche, ronde ou quadrangulaire, peinte d’un damier noir et blanc, souvent découpée à claire-voie d’un personnage ou d’un animal (oiseau, reptile…). Dès le soir, retentit le son mystérieux du rhombe, qui les convoque pour les initiations suivantes, qu’ils suivent rarement jusqu’à la troisième septennalité.

Masque-heaume degele, Sénoufo, village de Lataha, Côte-d’Ivoire. Bois. H. : 103 cm. Ex-coll. Josef Mueller, acquis d’Emil Storrer, vers 1950-1951. © Musée Barbier-Mueller. Photo Studio Ferrazzini Bouchet.
Un rôle essentiel est attribué à la figuration des ancêtres primordiaux Woulo no et Woulo tô, qui descendirent du ciel pour achever l’œuvre terrestre du créateur. Il s’agit parfois d’un rare couple de masques heaume degele, qui n’apparaît que tous les vingt-et-un ans, à la fin de la troisième septennalité, lors de la consécration des sages. Chaque figurine est faite d’un corps annelé, sans bras. Le mâle est reconnaissable à son carquois, vide d’apparence, mais contenant de redoutables flèches invisibles. Ce “Premier Couple” est très souvent représenté dans la statuaire, y prenant en fait le sens mythologique général de la création, le culte réel des ancêtres n’existant pas vraiment chez les Sénoufo. Il entre dans le groupe restreint des objets porpia, relevant du divin, et dont on ignore souvent la fonction. Nous les distinguerons des autres sculptures bandegele, limitées à des pratiques individuelles.

Figure féminine deble, « Premier maître de Lataha », Côte d’Ivoire, centre du pays sénoufo, vers 1900. H. : 98 cm.
© Museum Rietberg, Zurich, ex-coll. Emil Storrer, acquis vers 1952. Inv. RAF 301.
Les plus prestigieuses des réalisations porpia, sont les kpondo sion, mieux connus sous leur désignation de deble en langue tiga. Il s’agit, presque toujours, d’un exemplaire féminin tô, mais de rares couples ont déjà été vus. En fait, il n’en existerait que deux par bois sacré. Les initiés du haut degré kafo, les manient en l’honneur de leurs morts. Ils défilent à l’indienne, portant le premier au début, l’autre à la fin, en suivant la lente cadence des tambours funéraires, des sonnailles et de longues trompettes en bois. Ils frappent rythmiquement le sol avec le deble, honorant ainsi l’ancêtre mort, purifiant la terre et la rendant fertile. Les bras servent de poignées, et sont donc très souvent usés ou fort patinés. Ils sont plus longs que ne le voudraient de courts avant-bras, ramenés sur les hanches. De profil, une forte courbure dorsale, allant de la nuque au coccyx est contrebalancée par des seins galbés et un ventre bombé à hauteur de l’ombilic. De face, l’ensemble est au contraire très étroit, afin de libérer suffisamment de place pour les manipulations. Les jambes se terminent en une sorte de socle cylindrique et lourd, conçu pour pilonner la terre. Cette dernière partie manque souvent, bien que le bois choisi par les kulebele, soit toujours d’une essence très dure. Cette détérioration conduit à des confusions avec d’autres figurations du “Couple Primordial”, par exemple celles du très secret tyekpa, le poro des femmes. Dans le centre du pays, le visage de ces deble est nettement concave et se termine par un menton prognathe, qui se confond avec la bouche. La coiffure prend la forme d’un cimier, parfois renflé en avant par un toupet. Au nord, dans la partie malienne (Sikasso, San), cette silhouette fière et noble fait place à des formes plus tendues, schématisées et géométriques, avec des épaules et un buste carré, plaqué de seins coniques et horizontaux, nettement en rapport avec les sculptures bambara. Le style de l’ouest est plus arrondi, proche du réalisme. Parfois, la stricte symétrie du deble est rompue par des ajouts qui désorientent un peu, surtout si le lourd socle a disparu. L’élément mâle porte une hache ou une houe sur l’épaule, sa main droite tient un couteau ou un plantoir, le long de la hanche, évoquant le forgeron, sa tête peut être coiffée d’un disque ressemblant au kwonro. L’élément féminin est parfois surmonté d’une figure animalière de pangolin, et tient en main une boule de terre, ce qui rappelle la potière. Peut-être s’agit-il ici de statues appartenant au tyekpa des femmes ?

Figure d’oiseau setyen, kono, sibi ou porgarga, Sénoufo, Côte d’Ivoire. Bois et pigments. H. : 151,5 cm. © New York, The Metropolitan Museum of Art, The Michael C. Rockefeller Memorial Collection, legs de Nelson A. Rockefeller (1979). Inv. 1979.206.176. Photo Art Resource, N.Y.
La grande figure d’oiseau du poro, nommée setyen, kono, sibi ou porgarga, selon les régions, compte parmi les plus importantes de la catégorie porpia. Elle est devenue l’emblème moderne des Sénoufo. Bien que sa taille soit souvent très grande et son poids fort lourd, elle est maintenue sur la tête d’un porteur, pendant le défilé du cortège et la durée des chorégraphies. Elle symbolise toutes les générations à venir. C’est une combinaison hermaphrodite d’un grand oiseau symbolique (le calao pour certains, un autre oiseau pour d’autres), dont le long bec recourbé rejoint le ventre proéminent gravide, qu’il vient de féconder. Elle indique non seulement le devoir tribal de procréation, mais aussi, l’état gestatoire dans lequel se trouvent les néophytes avant leur initiation. Les ailes déployées sont habituellement peintes en damier, alors que le ventre est simplement tacheté de rouge et de blanc. Il existe un équivalent pour le poro des femmes, mais plus petit, ou porté par une figure féminine.

Maternité, Sénoufo, Côte d’Ivoire. Bois, H. : 63,6 cm. © The Cleveland Museum of Art, James Albert and Mary Gardiner Ford Memorial Fund. Inv. 1961.198. Photo H. Agriesti.
Comme pour la société poro des hommes, celui des femmes, ou tyekpa, détient une foule d’objets encore méconnus, mais semblant tous être relatifs à la fécondité et à la fertilité. Ce peuvent être ces exceptionnelles statues de maternité assises nong, qui donnent toujours leur sein gauche. Elles sont, en général, gravées de scarifications ou marquées de gaufrures aux commissures et surtout péri-ombilicales radiées, ces dernières étant essentielles dans leur symbolisme profond. Elles semblent attirer en avant cette partie de l’abdomen, la cambrure exagérée du dos contribuant à l’y pousser. Une épaisse patine de sang séché recouvre parfois l’ensemble. Elles se réfèrent à l’ancêtre mythique Katiéléo et apparaissent surtout lors des cérémonies funéraires, où les quatre pieds du tabouret servent de heaume aux porteuses. Des quantités de figurines animalières rappellent les tâches domestiques des épouses. Des statuettes féminines tié, plus réduites, debout ou assises, sont assez nombreuses. Celles qui occupent un tabouret tétrapode, les pieds éloignés du sol, les bras collés aux flancs, et portant parfois un vase au-dessus de la tête, ne doivent pas être confondues avec les figurines de daleu, fort semblables. Surtout si ces dernières ont été mutilées de leur canne par la première génération des collectionneurs d’art africain. Le rôle culturel des daleu est toujours resté ambigu, à cheval sur plusieurs liturgies différentes. C’est l’insigne des kafo, détenteurs de l’un des plus hauts degrés d’initiation du poro ; c’est l’arme sacrée du masque kpelie du groupe Tiembara qui, lui, sert à repousser les influences nuisibles ; c’est encore un emblème porté par les jeunes excisées, à la sortie de leur camp, ou bien la houlette du champion des cultivateurs.
Les rites agraires et, en particulier, ceux de la fête des ignames, sont souvent animés par des sculptures d’oiseau planeur kalioninge, que l’on tient fichés au bout d’une perche pendant la danse kurbi. Ils interviennent par couples, la femelle ayant, au-dessus d’elle, deux oisillons fixés au-dessus de chaque aile par une tige métallique torsadée. Une figurine féminine se dresse quelquefois au-dessus du corps.

Figure anthropomorphe kafigeledio, Sénoufo, Côte d’Ivoire. Bois, textile, terre et plumes. H. : 71,1 cm. © Coll. privée. Austin Kennedy/Paper Scenery, New York.
En ce qui concerne les objets bandegele, consacrés aux pratiques individuelles, nos connaissances ne sont que très fragmentaires. Les irigefolo des autels individuels ne semblent pas avoir été inventoriés, peut-être sont ils réduits à quelques charmes et statuettes mineures. En revanche, nous connaissons bien les kafigeledio, utilisés par les jeteurs de sorts. Mise à l’abri dans un sanctuaire dissimulé, cette statuette redoutable, reçoit régulièrement des sacrifices sanglants. Elle est coiffée d’une cagoule triangulaire garnie de plumes, auxquelles s’ajoutent, parfois, des piquants de porc-épic. Le menton s’orne d’une barbe de poils d’un animal de brousse et le reste du corps, dont on peut deviner l’élégance, est entièrement moulé d’une robe de toile empesée de sang. Le front, le nez et les reliefs oculaires transparaissent, ainsi que les seins et l’abdomen. Les deux bras sont emprisonnés dans de longues manches, prolongées ou doublées par une sorte de batte en bois. L’officiant peut jeter un sort à distance, en pointant l’une des manches dans la direction présumée de la victime.
Les devins sandogo utilisent des statuettes équestres plus rassurantes, bien qu’armées d’une lance, qui représentent un génie médiateur. Stylistiquement, elles se rapprochent de celles de leurs voisins Mandé, Dogon et Bambara, mais leurs pattes arrières et avant ne forment souvent qu’un seul bloc. Des réductions de ces cavaliers sont exécutées à la cire perdue par la caste endogame des fondeurs. Des formes semblables sont aussi réalisées par les fondeurs Koulango et même par ceux des Abron qui sont pourtant de culture Akan. Les devins consultent aussi des figures de couples anthropomorphes, assis sur un banc, côte à côte, pouvant se tenir par l’épaule, comme les ancêtres primordiaux dogon.
Les devineresses sandobele représentent un groupe beaucoup plus important. Elles sont particulièrement consultées pour les questions de fécondité et de délits sexuels. Elles ont pour emblème une grande statue féminine puguwo, coiffée d’une coupe ou d’un mortier. Elles la transportent, maintenue sur leur tête, lors des processions de la fête des ignames. À cette occasion, on peut remarquer l’emploi de bacs à manducation, proches de ceux des Dogon, mais dont les flancs sont sculptés de masques en bas-relief.

Masque kodal, « Maître du visage concave », centre ou nord du pays sénoufo, Côte d’Ivoire, avant 1900. H. : 26 cm.
© Museum Rietberg, Zurich, don de Novartis, ex-coll. Roger
Bediat, avant 1939 ; Patrick Girard. Inv. 2011.3.
Les cases sacrées recèlent aussi de nombreux masques, avec leurs ornements. Ce peuvent être des masques faciaux anthropomorphes kpelie. Assez plats, de petite taille, de forme ovale, assez souvent centrés d’un petit nodule frontal, faisant référence à leur féminité. Ils sont attachés à des arceaux de rotin où est fixée la garniture de tissu qui recouvrira la nuque du porteur. Leurs yeux ont souvent la paupière supérieure découpée, le nez est long, fin, avec de petites narines. La bouche est petite, ronde ou ovale, en légère saillie et montre ses dents, rappelant un peu, par cela, les masques gouro. Le menton est long et anguleux. Ces masques s’enrichissent d’ornements périphériques dits d’inspiration mandé. Ceux-ci sont de trois ordres : il s’agit, tout d’abord, d’éléments frontaux figuratifs, presque toujours des emblèmes de groupe (soit l’un des cinq animaux mythologiques, soit une tête humaine, une paire d’ailes, le fruit épineux du kapokier, une noix de palme…), auxquels se surajoute, souvent et peut-être récemment, une paire de cornes de bélier ; ce sont, en second lieu, des éléments latéraux, géométriques, rectangulaires ou semi-circulaires, hachurés, voire ajourés ; enfin, existent deux éléments inférieurs pédonculaires encadrant le menton, rappelant nettement les pieds de masques n’domo des Bambara méridionaux. De nombreuses variantes surgissent selon les fractions.
Chez les Paralha du nord-est, le nez peut s’allonger en un long bec, ou les cornes se relever et s’aplatir, comme celles d’un buffle, à la manière des Dyoula du centre et des voisins orientaux Koulango. Pourtant purement mandé, les Dyoula ont adopté le masque kpelie des Sénoufo, mais en le dépouillant de certains éléments jugés dangereux, et ne l’utilisant que lors des réjouissances publiques. Ils le plaquent parfois de cuivre, comme les Marka, ou fondent franchement des modèles en laiton.

Masque double, Sénoufo, Côte d’Ivoire. Bois, H. : 32 cm. © Coll. Laura et James J. Ross. Photo John Bigelow Taylor.

Masque, Sénoufo, Côte d’Ivoire. Bois et clous de tapissier. H. : 36 cm. © National Museum of African Art, Smithsonian Institution, Washington, DC. Gift of Walt Disney World Co., a subsidiary of The Walt Disney Company. Inv. 2005-6-50. Photo Franko Khoury.
Les Kuffulo du centre, emploient volontiers des masques doubles, qui, selon Holas, ne seraient pas des masques de jumeaux originels, mais une réduction en un seul élément du couple qui aurait dû évoluer. Au sud-est, dans les fractions Tagwana et, plus à l’est, celles des Djimini, les pédoncules tendent à disparaître et les marques linéaires gaufrées s’affirment aux commissures, comme des moustaches de chat. La face devient plus bombée, avec un menton plus rond. Les rebords palpébraux deviennent plus courbes au lieu d’être rectilignes. Les cornes sont de plus en plus proches de celles des modèles koulango, ou font place à des coiffures sculptées avec des cannelures, des volutes ou des macarons. Une polychromie rouge, blanche, où domine parfois le bleu à linge, peut quelquefois les enrichir.
Quatre masques d’étain, fort anciens, auraient été mis au jour à partir de tombeaux, et témoigneraient de l’ancienneté du canon morphologique culturel kpelie.
Autant ces masques anthropomorphes délicats et finement exécutés, traduisent un sentiment de beauté, de noblesse, de féminité, autant les heaumes zoomorphes poniugo, expriment la virilité, et sont exécutés avec vigueur, cherchant à impressionner, voire à terrifier. En fait, lorsqu’on analyse bien ces types de masques, les kpelie comportent des éléments animaliers et les poniugo un visage proche de l’humain.

Masque heaume korobla. Sénoufo, Côte d’Ivoire. Bois. L. : 114 cm, The Museum for African Art, New York, don de Corice Canton Arman. Inv. 2010.02. Photo Jerry L. Thompson.
Il existe quatre types de heaumes, dont la forme générale est à peu près la même : il s’agit d’un casque hémisphérique à visage semi-humain, orné de grandes oreilles pointues et d’une mâchoire allongée, plus ou moins plate et rectangulaire, rappelant celle du crocodile. Si ce heaume ne comporte pas de dents, il s’agit du rare gbodiugu, qui apparaît en cours d’initiation du poro. Si le même est garni de dents acérées, c’est un korobla, instrument défensif, chargé d’écarter les esprits malfaisants, de détecter les sorciers et de conjurer leurs sorts. Il joue aussi un rôle funéraire, chevauchant le mort, pour en chasser l’âme à grands cris. Il ne comporte aucun appendice sculpté surajouté, comme les suivants, et s’individualise donc par deux bouquets de plumes et de pointes de porc-épic ou de hérisson, implantés dans une petite ouverture du front et du nez, rappelant ainsi le masque komo des Bambara. Il prend assez fréquemment la forme janus. On l’appelle aussi “masque cracheur” car, la nuit, il arrive que le danseur, fort agité, souffle, par l’orifice de la gueule, une poignée de paille et de résine, enflammée par une braise. Si se surajoute une paire de cornes d’antilopes et, parfois, une effigie animalière frontale (caméléon, oiseau ou cornes de bélier), c’est un masque gpelige, reconnaissable en plus à son couvre-nuque raidit par le sang sacrificiel. Il intervient, lors des initiations du poro, et joue, comme le précédent, un rôle funéraire, en frappant un tambour, afin de pousser, sans retour, l’âme du mort vers kubelekaa, le séjour des trépassés.

Masque casque janus wanyugo, Ladiokaha, Région des Savanes, Côte d’Ivoire. Bois et pigment. Dim. : 34,3 x 25,7 x 64,7 cm. © The Michael C. Rockefeller Memorial Collection, Gift of Nelson A. Rockefeller, 1964. Inv. 1978.412.311.
Enfin, lorsque s’adjoignent des pointes de phacochères et, surtout, la petite cupule frontale à philtre wa, il s’agit d’un masque waniugo, dont le rôle est uniquement magique. Le wa peut manquer et se trouver remplacé ou renforcé par des paquets de substances actives, souvent fixés dans la gueule. Comme le korobla, il peut prendre l’aspect d’un janus. C’est un instrument d’agression, capable de maléfices, mais jouant aussi un rôle dans les ordalies ou les phénomènes météorologiques. Un cinquième heaume zoomorphe, propre à la fraction Nafara, est détenu par chaque confrérie du poro pour l’initiation au kagba ou au nassolo. Il s’agit d’une réduction du gpelige, sans animal allégorique frontal, fixée en avant d’une grande et longue carcasse en forme de toit à deux pentes. Cette sorte de tente est tapissée d’une toile à décor géométrique et prolongée jusqu’au sol par un rideau de fibres. Un homme et parfois deux ou trois s’y cachent, tout en faisant cheminer le monstre. Ils actionnent un instrument à friction, qui émet des sons rauques destinés à faire fuir les non initiés. Dans la zone malienne de Sikasso, F. H. Lem avait observé deux masques casques de bois, en forme de bol retourné, où se déploient, sur le devant, les cornes d’une tête de buffle et, sur l’occiput, un petit cavalier armé ou un cervidé. Le forgeron Kourouma les interpréterait comme des casques individuels de chasseurs ou de guerriers. On en connaîtrait moins d’une dizaine, réalisés en laiton, et dont le plus ancien aurait été extrait d’une tombe, en plein pays Baoulé. Ceci fait émettre l’hypothèse qu’ils puissent être restés en place depuis le XVIe siècle, époque du retrait de la fraction Kiembara vers Korhogo.

Casque, Sénoufo, Côte d’Ivoire. Bois, métal, fibres et pigments. H. : 52 cm. Ex-coll. F.-H. Lem ; Helena Rubinstein. © Newark Museum, achat 1966, The Member’s Fund. Inv. 66.619.
Il existe une foule d’objets secondaires, tous exécutés avec raffinement, comme les étriers de poulies des tisserands que surmonte souvent l’oiseau setyen, mais aussi un masque kpelie, imprégnant de rituels ancestraux l’action du tisserand. Parfois, c’est une tête de buffle, plus rarement une main ou une tortue. Ceux des Djimini s’ornent de masques kpelie, caractéristiques de la région, ou d’une tête d’oiseau qui voit se creuser un ressaut entre le bec et une certaine avancée du front, laquelle peut parfois se montrer volumineuse. Sont encore enrichis de rondes-bosses ou de motifs, les serrures, les mortiers, les louches rituelles, les fauteuils de chef, plus abondamment sculptés que ceux des Bambara, les pots à beurre de karité parfumé, dont les couvercles sont décorés d’un oiseau, d’un masque korobla ou d’une figurine féminine.

Pendentif « jumeaux », Sénoufo ou Tussian, nord de la Côte d’Ivoire ou sud-ouest du Burkina Faso. Laiton. Dim. : 5,1 x 4,7 x 0,6 cm. © The Michael C. Rockefeller Memorial Collection, Gift of M. and Mrs. John J. Klejman, 1964. Inv. 1978.412.496.

Bague yawiige ornée d’un caméléon, Sénoufo, Côte d’Ivoire, Mali ou Burkina Faso. Laiton. H. : 3,8 cm. © The Bryce Holcombe Collection of African Decorative Art, Bequest of Bryce Holcombe, 1984. Inv. 1986.478.29.
En dehors des cavaliers utilisés par les guérisseurs, les fondeurs kpeembele réalisent d’innombrables autres charmes yawige, qui peuvent aussi prendre la forme de pendentifs figurant les cinq animaux ou de bagues d’hommes surmontées d’un caméléon. De nombreux modèles évoquent des jumeaux, côte à côte, et même des triplés, dont les jambes se confondent en un large triangle plat. Des bracelets de cheville ou de poignet, ont presque toujours la forme du python. La bague-insigne de l’association des guérisseurs nokariga, est beaucoup plus rare. Elle a pour chaton une large tête de buffle, en souvenir du chasseur fondateur qui fit grâce au buffle en échange de ses connaissances des herbes. Lors du décès d’un membre, elle est portée en bouche par son successeur.

Bague nokariga ornée d’une tête de buffle, atelier Tyebara, Korhogo, Sénoufo, Côte d’Ivoire. Laiton. Dim. : 9 x 6,5 x 3.2 cm. © Museum Rietberg, Zurich, ex-coll. Emil Storrer, avant 1954-vers 1970, ex-coll. Denise Zubler, Bâle et Zürich. Inv. 2013.188.

Figurine, Senufo ou Tussian, nord de la Côte d’Ivoire ou sud-ouest du Burkina Faso. Alliage de cuivre. H. : 4,1 cm. © The Michael C. Rockefeller Memorial Collection, Bequest of Nelson A. Rockefeller, 1979. Inv. 1979.206.41.
À cause d’abandons massifs d’objets, suivis de remplacements, liés à des autodafés commis par les adeptes de cultes nouveaux (comme celui du massa ou alakora, dédié à la corne de bélier), les objets sénoufo apparurent, à une certaine époque, en surabondance. Ils ont peut-être subi des influences morphologiques originales, lors de leur réapparition culturelle. De toute façon, les liens stylistiques des statuettes du nord avec celles des Bambara et des Dogon sont évidentes, et se sont sans doute aussi installées au fil des temps, en particulier pour les masques zoomorphes, très proches des masques komo Bambara. Quant aux masques kpelie, leur bouche basse et protruse évoque le style des Mandé Gouro du sud-ouest, et leurs coiffures cornues en peigne, celui des masques n’domo des Bambara du nord.
*Article publié dans notre magazine Le Monde de l’Art Tribal, printemps 1995, N° 5, pp. 44-53. Spécialisé dans la pathologie tropicale, le docteur Pierre Harter a passé trente-trois ans de sa vie en Afrique. Sa donation de sculptures bamiléké et bamoum est aujourd’hui l’un des fleurons du MQB, à Paris. Harter part en Afrique en 1957. Tout en soignant les Camerounais atteints de lèpre et de malaria, le médecin les regarde et les écoute. Il devient un des leurs, pénètre au sein des sociétés secrètes et est admis aux cérémonies initiatiques les plus confidentielles. De retour en France, il ne cessera pas d’enrichir et d’étudier sa collection. Il effectuera un dernier voyage en Afrique en 1985 et meurt en 1991.

Figure féminine deble, Sénoufo, Côte d’Ivoire. Bois. H. : 104 cm. © Yale University Art Gallery, New Haven, CT., Charles B. Benenson, B.A. 1933, Collection. Inv. 2006.51.60).
The Senufo
by Dr. Pierre Harter
The Senufo belong to the Voltaic or Gour linguistic group and today number more than two millions people. They are divided into some thirty sub-groups, covering Mali, Burkina Faso and particularly Côte d’Ivoire, where Korhogo, the main center, is located. Some Senufo sculpture is carved for use in individual practices of lesser importance, such as family and divinatory rites and the casting of spells, but their art is more widely identified with the complex and still largely unknown rituals of the important and secret poro or lo initiatory society, the existence of which is necessitated by the Senufo’s evolutionary conception of the world. The poro goes well beyond the Senufo sphere of influence, and extends as far as Guinea (the Kono and Toma), Liberia (the Mano, Kpelle or Guerze, Dan Geh, Dan Guio, Kra, Konor, Buzi, Gbande, and Bassa), and to Sierra Leone (the Sherbro, Kissi, Mende). According to myth, the creator of the universe Koutiéléo, whose sex is ambiguous, first separated the waters from the earth. Then he created the five mystical animals the antecedents of the five main Senufo families: the chameleon, the first born, symbolizing intelligence; the python, recalling the fertilizing water and the male carrier of life; the hornbill, associated with the notion of procreation; and finally the crocodile and the tortoise. During the second phase, man appeared, but only as a physical entity, still remaining in some kind of animal form. It was only in the third phase that man was “illuminated”, and this phase is now commemorated and renewed through the initiation of the poro. Its aim is to reveal to neophytes the meaning of the universe, arts and crafts, rearing of animals and cultivation of plants. The legend recounts that the communities then organized themselves into complete microcosms of Koutiéléo, incarnating themselves in each village into a female active substitute called Katiéléo, the “old mother”. The supreme god is never sculpted, but only represented by symbols.

Canne, Sénoufo, Côte d’Ivoire. Bois patiné. H. : 105 cm. © Ex-coll. Carlebach. Coll. M. Itzikovitz. Photo B. Cavanagh, Paris.
The members of the poro receive an exceptionally long training, given by degrees, often quarterly, which may extend over three seven-year phases. They obey a harsh, complex hierarchy. They express themselves in an archaic language or tiga, which designates each object with a new word, in addition to its profane name. This often creates confusion in identifying artifacts. The terms may also change according to the ethnic sub-groups. Each step forward in the poro constitutes a kind of age class, and requires its own carved artifacts. Among the Senufo, unlike the Dogon and Bamana, these objects are not made by the smith cast, but by professional carvers, the kulebele. The major part of the initiation is performed in the sacred grove, sinzanga, in the middle of which is a clearing, where there are huts concealing the ritual artifacts. These sanctuaries are sealed by magnificent doors with carved exteriors. In the middle of the door panels there is a circular, navel-shaped relief, a beneficial sign related to the hut. It is surrounded by a solar circle, from which four rays diverge, pointing toward the corners. Above and below there appear animals, figures or masks, whose heads point toward the center. The end of the adolescents’ training period is marked by obtaining the rank of kwonro.

Parure de tête, Sénoufo, Côte d’Ivoire. Bois, fibres, jonc et tissu de coton. H. : 99,1 cm. © The Metropolitan Museum of Art, New York, don de M. et Mme J. Gordon Douglas III, 1984. Inv. 1984.514.3).
During this ceremony, the initiates file by wearing cane caps, each surmounted by a round or rectangular plank, painted as a black and white checker-board, often cut out in openwork with a figure or an animal (reptile, bird…). In the evening, the mysterious sound of the bull-roarer rings out, summoning them to the next initiations, but few follow through as far as the third seven-year period. A crucial role is placed on the representation of the Primeval Ancestors Woulo no and Woulo tô, who descended from heaven to complete the creator’s work on earth. These are sometimes embodied in a rare pair of degele helmet masks which appear only every 21 years, at the end of the third seven-year period, during the consecration of the elders. Each small figure consists of an armless, ringed body. The male is recognizable by his apparently empty quiver, which in fact contains fearful, invisible arrows.

Couple, Sénoufo, Côte d’Ivoire. Bois. H. : 115 et 97 cm. © Coll. privée. Courtesy McClain Gallery, Sotheby’s.
This Primeval Couple is often represented in statuary, taking on the general mythological meaning of creation, since real ancestor worship does not really exist among the Senufo. These figures fall within the restricted group of divine-related porpia artifacts, whose actual function is often unknown. We shall distinguish them from the other bandegele carvings, restricted to individual practices. The most prestigious of the porpia carvings are the kpondo sion, better known by the term of deble in the tiga language. These are almost always female tô, but a few couples have been observed. In fact there would only two exist for every sacred wood. The initiates of the upper degree kafo, use them in honor of their dead. They march in single file, carrying one at the front and the other at the end, following the slow rhythm of the funereal drums, bells and long wooden trumpets. They beat the ground rhythmically with the deble, thereby honoring the dead ancestor, purifying the earth and making it fertile. The arms serve as handles, and are therefore often very worn or highly patinated. They are longer than would suggest the short forearms resting on the hips. In profile, a strong curve of the back from the nape to the coccyx is counterbalanced by rounded breasts and a belly protruding at the navel. Face-on, the figure is very narrow, in order to leave enough room for handling. The legs end in a heavy, cylindrical base, designed to pound the earth. This base is often missing, although the wood chosen by the kulebele is always of a very hard variety. This deterioration leads to confusion with other representations of the Primeval Couple, for example those of the highly secret tyekpa, the women’s poor. In the center of the Senufo region, the face of the deble is distinctly concave and ends in a protruding chin, which blends in with the face. The hairstyle takes the form of a crest, sometimes with a tuft projecting forward. In northern Mali area (Sikasso, San), this proud and noble outline gives way to tighter, more schematic and geometric forms, with square shoulders and chest, conical, horizontal breasts, clearly reminiscent of Bamana carvings. The western style is more rounded and naturalistic. Sometimes, the strict symmetry of the deble is broken by additions, which may lead to confusion, particularly if the heavy base has disappeared. The male partner carries an axe or a hoe on his shoulder; his right hand holds a knife or a dibble on the hip evoking the smith; and his head may bear a disk resembling the kwonro. The female partner is sometimes surmounted with an animal figure, a pangolin, and holds a clod of earth in her hand, recalling the potter. These statues may belong to the women’s tyekpa ? The large bird figure of the poro, which is named setyen, kono, sibi or porgarga, according to the region is among the most important in the porpia category. It has become the modern emblem of the Senufo. Although it is often very big and extremely heavy, it is kept on the head of a bearer during the passing of the procession and throughout the length of the dances. It symbolizes all the generations to come. It is a hermaphroditic combination of a symbolic bird (some say the hornbill, others a different bird), whose long hooked beak touches the gravid protruding belly that it has just fertilized. It represents not only the tribal duty of procreation, but also the state of gestation in which the neophytes find themselves before their initiation. The outspread wings are usually painted with a checker-board pattern, whereas the belly is merely spotted with red and white. There exists an equivalent for the women’s poro, but this is smaller or carried by a female figure.

Récipient à caryatide. Sénoufo, Côte d’Ivoire. Bois. H. : 29,7 cm. © Coll. privée. Photo Studio Asselberghs-Dehaen, Bruxelles.
As with the men’s poro society, the women’s or tyekpa has a great number of artifacts that are still largely unexplained, but seem to relate to fecundity and fertility. They may be these outstanding seated maternity figures, nong, which always proffer their left breast. They are usually marked with scarifications and especially radiating peri-umbilical designs in relief, that are essential in their deep symbolism. The umbilicus seems to pull the abdomen forward, and the exaggerated arch of the back contributes to that emphasis. A thick patina of dried blood sometimes covers the whole form. The nong figures refer to the mythical ancestor Katiéléo and appear particularly during funeral ceremonies, in which the four feet of the stool act as a helmet for the female bearers.

Figurine féminine, Sénoufo, Côte d’Ivoire. Bois. H. : 19 cm. © Coll. Mina et Samir Borro, Bruxelles.
Large numbers of small animal figures recall the wives’ domestic tasks. Smaller female statuettes, tié, either standing or seated, are quite numerous. Those sitting on a four-legged stool, with their feet off the ground and their arms by their sides, sometimes carrying a vase on the head, should not be confused with the similar daleu figurines, which frequently have been sawed off their canes by the first generation of African art collectors. The cultural role of the daleu has always been ambiguous, covering several different set of practices. It is the emblem of the kafo, who possess one of the highest degrees of initiation in the poro; it is the sacred weapon of the kpelie mask of the Tiembara group, which uses it to ward off harmful influences; it is an emblem worn by the young excised girls when they leave their camp; or it is the trowel of the farmers’ champion. Agrarian rites, in particular those of the yam festival are often enlivered by gliding carved wooden birds, kalioninge, which are stuck on the end of a perch during the kurbi dance. They come in couples, with the female having two chicks above her, one fixed on each wing by a twisted metal wire. A small female figure sometimes rises over the body. With regard to the bandegele artifacts, devoted to individual practices our knowledge is very fragmentary and we have no inventory of the irigefolo, individual altars, although they may be summed up by a few charms and minor statuettes. However, we have some knowledge of the kafigeledio used by wizards. This fearsome statuette hidden away in a concealed sanctuary regularly receives bloody sacrifices. It wears a triangular hood decorated with feathers, to which are sometimes added the quills of a porcupine. The chin is adorned with a hair beard from a bush animal, and the rest of the handsome body is fully fitted with a blood-starched cloth robe. The brow, the nose and the reliefs of the eyes show through, as do the breasts and the abdomen. Both arms are enclosed in long sleeves that are extended or doubled by a kind of wooden bat. The officiant may cast a spell from a distance by pointing one of the sleeves in the presumed direction of the victim.

Statuette équestre syonfolo, « Maître des mains en spatule », centre du pays sénoufo, Côte d’Ivoire, vers 1920. Bois. H. 32,1 cm. © Dallas Museum of Art ; don de la McDermott Foundation, à la mémoire d’Eugene McDermott. Inv. 1974. SC.14. Ex-coll. Gustave et Franyo Schindler.
The sandogo wizards use equestrian statuettes that are a bit more reassuring, despite being armed with a lance, and which represent a mediating spirit. Stylistically they are close to those of their Mande, Dogon and Bamana neighbors, but the forelegs and hindlegs often each form a single block. Smaller versions of these horsemen are made by the “lost wax” method by the endogamic cast of smelters. Similar forms are also made by the Koulango casters and even by the Abron, who are of Akan culture. The wizards also consult figures of anthropomorphic couples, sitting side by side on a bench and sometimes holding each other by the shoulders like the Dogon primeval ancestors. The sandobele female wizards represent a far more important group. They in particular are consulted about questions of fecundity and sexual crimes. Their emblem is a large female statue, puguwo, with a cup or mortar on her head. They carry her on their heads during the processions of the yam festival. At this time, the use of manducation troughs may be observed, rather like those of the Dogon, although their sides are carved with masks in low-relief. Numerous masks, with their ornaments, are strored in the sacred huts. These may be anthropomorphic face masks, kpelie, which are somewhat flat, small, oval-shaped, with a small frontal nodule referring to their femininity and quite often positioned in their center. They are tied to cane hoops, on which is fixed the cloth trimming covering the bearer’s nape. Their upper eyelids are often cut out and their noses are long and thin with small nostrils. Their mouths are small, either round or oval, slightly protruding and bearing their teeth, thereby recalling Gouro masks. Their chins are long and angular.

Masque-heaume kponyugu, atelier ou maître inconnu de la région de Korhogo, centre du pays sénoufo, Côte d’Ivoire, vers 1930. Bois, fibres et pigments. H. : 32,5 cm. © Rietberg Museum, Zurich, don de Rahn & Bodmer. Inv. RAF 321. Ex-coll. Emil Storrer, acquis en 1953.
These masks are enhanced by peripheral ornaments said to be of Mande inspiration. These ornaments are of three types:
1 - Figurative frontal elements, almost always group emblems (either one of the five mythological animals, or a human head, a pair of wings, the spiny fruit of the kapok tree, a palm nut… to which is frequently of ram’s horns, although these may be a recent innovation.
2 – Lateral, geometric, rectangular or semi-circular elements that may be hatched or in openwork.
3 – Two downward-curving lower elements at either side of the chin, distinctly reminiscent of the “feet” of the n’domo masks of the southern Bamana.
Many variants arise according to the sub-group. With the Paralha of the north-east, the nose may extend into a long beak, or the horns may rise and flatten out like a buffalo’s, as with the Dyoula of the central region and their eastern Koulango neighbors. The Dyoula, who are pure Mande, have adopted the kpelie mask of the Senufo, but have stripped it of certain elements considered dangerous, and use it only during public celebrations. They sometimes plate them with copper as the Marka do, or cast models in brass. The Kuffulo of the central region often use double masks which, according to B. Holas, are not masks of primeval twins, but a small version in one part of the couple that should have evolved. In the south-east, in the Tagwana sub-groups, and further east with the Djimini, the lower projections tend to vanish and embossed lines show up in the commissures, like cat’s whiskers. The face becomes rounder, as does the chin. The edges of the eyelids become curved rather than straight. The horns are much closer to those of the Koulango models or are replaced with headdresses carved with grooves, curls or coils. They are often enhanced by red and white coloring, accented by the powdery blue of laundry bluing.

Masque-heaume kponyugu, atelier ou maître inconnu de la région de Korhogo, centre du pays sénoufo, Côte d’Ivoire, vers 1930. Bois, fibres et pigments. H. : 32,5 cm. © Rietberg Museum, Zurich, don de Rahn & Bodmer. Inv. RAF 321. Ex-coll. Emil Storrer, acquis en 1953.
Four very ancient tin masks are supposed to have been discovered in tombs, and these would confirm to the antiquity of the kpelie cultural and morphological tradition. In as much as the delicate, finely worked anthropomorphic kpelie masks convey a feeling of beauty, nobility and feminity, so the poniugo zoomorphic helmets in contrats express virility, and they are made with vigor in an attempt to impress or even terrify others. In fact, careful analyses reveals that the kpelie have animal elements about them, while the poniugo have a nearly human face.

Masque heaume, Sénoufo, Côte d’Ivoire. Bois, clous, laiton, fibres végétales et plumes. H. : 180 cm (avec costume). © Musée royal de l’Afrique centrale, Tervuren, achat, 1965. Inv. EO.1965.23.1-1. Photo Studio Asselberghs-Dehaen.
Four types of helmets exist, the general form of which is practically the same: a hemispheric mask with a semi-human face, large, pointed ears and a long, more or less flat or rectangular jaw, reminiscent of a crocodile’s. When this helmet has no teeth, it is the rare gbodiugu, which appears during the initiation of the poor. If it is equipped with sharp teeth, then it is a korobla, an instrument of defence, responsible for warding off evil spirits, detecting wizards and averting their spells. It also plays a funereal role, riding the dead person to chase away his soul with loud screams. It has no additional carved appendage as the following do, and is therefore individualized by two bunches of feathers and porcupine or hedgehog quills, fitted into a small aperture in the forehead and nose, and thus recalling the komo mask of the Bamana. Quite frequently it is janiform. It is also called the “firespitter”, since sometimes during the night the highly excited dancer blows a handful of straw and resin set alight by a cinder through the orifice of the mouth. If there mask also has a pair of antelope horns, and sometimes a frontal animal effigy (chameleon, bird, ram’s horns), then it is a gpelige mask, further recognizable by its scarf stiffened with sacrificial blood. It is used during the poro initiations, and plays a funereal role, as does the previous one, by beating a drum to push the deceased person’s soul irrevocably towards kubelekaa, the land of the dead. Finally, when wart hog tusks, and particularly the small frontal philter cup, wa, are included then the mask is a waniugo, the role of which is purely magic. The wa may be absent and replaced or reinforced by packets of active substances which are often set in the mouth. Like the korobla, it may be janiform. It is an instrument of aggression capable of evil doings, and also plays a role in ordeals and meteorological phenomena. A fifth zoomorphic helmet, belonging solely to the Nafara sub-group, is owned by each brotherhood of the poro for initiation to the kagba or Nassolo. This is a smaller version of the gpelige, without a frontal allegorical animal, set in front of a huge, long carcass in the form of a roof with two slopes. This kind of tent is woven out of a cloth with a geometric design and extended to the ground by a curtain of fibers. A man, sometimes two or three, hides inside, making the monster move along. They play a percussion instrument, which emits raucous sounds intended to chase away the uninitiated. In the area of Sikasso, in Mali, F. H. Lem observed two wooden helmet masks in the form of upside-down bowls, from which buffalo horns rose on the front, and a small armed horseman or deer on the rear. The Kourouma smith would interpret them as individual helmets of hunters or warriors. Fewer than a dozen made of brass are known, the oldest of which is supposed to have been removed from a tomb in the heart of the Baoule region. This invites the theory that they may have existed since the 16th century, when the Kiembara sub-group moved to Korhogo. There exist many secondary artifacts, all finely made, such as the weavers’ heddle pulley, which is often surmounted by the setyen bird, or at time by a kpelie mask, ennobling the weaver’s action with ancestral rites. Sometimes it may have a buffalo head, and less frequently a hand or a tortoise. Those of the Djimini are adorned with the characteristic kpelie masks of the region or with a bird’s head which has a ridge between its beak and a protuberance of the forehead, at times quite large.

Tambour, Sénoufo, Côte d’Ivoire. Bois. H. : 122,9 cm. © The Art Institute of Chicago, Robert J. Hall, Herbert R. Molner Discretionary, and African and Amerindian Art Purchase funds. Inv. 1990.137.
Door locks, mortars, ritual ladles, chieftain’s chairs — more richly carved than those of the Bamana — and perfumed shea butter dishes, the lids of which are decorated with a bird, a mask or a korobla female figure are also enhanced by decorative motifs or sculptures in the round. In addition to the horsemen used by the healers, the kpeembele casters make many other charms, yawige, which may take the form of pendants depicting the five animals, or of men’s rings surmounted by a chameleon. Many versions represent twins, side by side, and even triplets, whose legs come together in a large flat triangle. Ankle or wrist bracelets almost always have the form of the python.The insignia ring of the healers’ association, nokariga, is far rarer. Is displays a large buffalo head in memory of the founding hunter who spared the buffalo in exchange for its knowledge of herbalism. When a member dies, it is carried in his successor’s mouth.
Because huge numbers of artifacts have been relinquished under duress and replaced by the adepts of new cults (such as the massa or the alakora devoted to the ram horn), Senufo artifacts seem exceptionally abundant. They may have undergone original morphological influences at the time of their cultural reappearance. Nevertheless, the stylistic links of the statuettes of the north with those of the Bamana and Dogon are obvious and undoubtedly must have evolved over a long period of time. This is especially true of the zoomorphic masks, which are very close to the Bamana komo masks. The low, protuberant mouths of the kpelie masks evoke the style of the Mande Gouro of the south-west and their horned coiffures with a comb recall the Bamana n’domo masks of the north.
BIBLIOGRAPHY
CONVERS, Père Michel, « Masques en étain sénoufo », Arts d’Afrique Noire, N° 16, Hiver 1975, pp. 24-36 ; « L’Aventure de Massa en Pays Sénoufo », Primitifs, N° 6, Septembre/Octobre 1991, pp. 24-34 : « Une suite… à l’aventure de Massa en pays sénoufo », Le Monde de l’Art Tribal, N° 13, printemps 1997, pp. 52-66.
BOCHET, G., « Les Masques sénoufo, de la forme à la signification », Bulletin de l’I.F.A.N., T. XXVII, série B., N° 3/4, 1965, p. 636.
GLAZE, A., « Woman power and art in a Senufo village », African Arts, Spring 1975, vol. VIII, N° 3, p. 24 ; « Senufo Ornament and Decorative Arts », African Arts, Nov. 1978, vol. XII, N° 1, p. 63.
GOLDWATER, R., Senufo Sculpture from West Africa, Museum of Primitive Art, New York, 1964.
HOLAS. B., Arts de la Côte d’Ivoire, P.U.F., 1966 ; Sculpture sénoufo, Centre des Sciences Humaines, C.I., 1964 ; Masques Ivoiriens, C.S.H., 1969 ; Animaux dans l’art ivoirien, Geuthner, 1969.
KOUROUMA, M., « Un Africain nous parle de l’art de son peuple », Arts d’Afrique Noire, Été 1983, N° 46, p. 31.
LEM, F. H., Sculptures Soudanaises, Arts et Métiers Graphiques, 1948.
RICHTER, D., « Senufo Mask Classification », African Arts, May 1978, vol. XII, N° 3, p. 66.


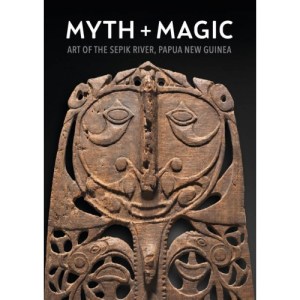






















































































































![Gottfried Lindauer, « Kewene Te Haho [?-1902] ». Huile sur toile, non datée, 85 x 70 cm. Auckland Art Gallery Toi o Tāmaki, don de H. E. Partridge, 1915. Réf. : 1915/2/17. D’après le journal « West Coast Times », Kewene Te Haho serait mort à près de quatre-vingt-dix ans, dans sa maison, à Te Makaka, un avant-poste presbytérien, dans le port d’Aotea. Il participa à la bataille de Taumatawiwi, en 1830, où s’affrontèrent Te Waharoa de Tainui et l’iwi Ngāti Maru d’Hauraki. Membre de la Wesleyan Congregation, en tant que prédicateur, il lutta contre les méfaits de l’alcoolisme. Il tient dans sa main droite un large mere en bois orné d’une figure tipuna (ancêtre).](https://philippebourgoinarttribal.com/wp-content/uploads/2015/03/kewene-te-haho.jpg?w=246&h=300)


![Gottfried Lindauer, « Maori Plaiting Flax Baskets [Femmes tressant des vanneries kono et kete en harakeke (lin, Phormium tenax)] », 1903. Huile sur toile, 217,5 x 265 cm. © Auckland Art Gallery Toi o Tāmaki, don de H. E. Partridge, 1915. Réf. : 1915/2/63.](https://philippebourgoinarttribal.com/wp-content/uploads/2015/03/maori-plaiting.jpg?w=300&h=243)